Quand la patience américaine s’évapore… et que l’Europe commence à transpirer
Donald Trump semble désormais vouloir tourner la page sur son rôle de médiateur dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie. Après avoir promis qu’il mettrait un terme à la guerre en seulement 24 heures s’il était aux commandes, l’ancien président constate les limites de la diplomatie face à une impasse prolongée. Face à l’absence de progrès concrets, il n’exclut plus de retirer l’engagement américain et de laisser les Européens et les Ukrainiens gérer eux-mêmes la suite des événements. Traduction : “L’Europe ? L’Ukraine ? Faites comme vous voulez, moi j’ai golf.”
Vendredi 18 avril, devant un parterre de journalistes, le président américain a haussé le ton :
“Si l’une des deux parties continue de rendre les choses impossibles, on leur dira qu’ils sont stupides, qu’ils sont horribles, et on tournera la page.” L’élégance diplomatique, version Trump, depuis la Maison Blanche.
L’OTAN, c’est sympa… tant que l’Amérique paie
Ce n’est pas un secret : sans les États-Unis, l’OTAN, c’est un peu comme une armée de scouts sans chef. Financement, troupes, logistique, missiles, popcorn… l’Amérique fait (presque) tout. Et là, le chef d’orchestre commence sérieusement à envisager de poser la baguette. Les Européens, qui depuis trois ans s’accrochent à l’épaule de l’Oncle Sam, pourraient bientôt devoir affronter Vladimir Poutine en solo. Bon courage.
Trump, qui n’a jamais caché son exaspération face aux tergiversations européennes et aux hésitations ukrainiennes, est maintenant à deux doigts de leur dire : “Démerdez-vous, moi j’ai un mur à construire.” Bref, des choses plus prioritaires qu’une guerre à l’autre bout du monde.
87 jours de tentatives, et toujours rien
Côté diplomatie, c’est le calme plat. Marco Rubio, secrétaire d’État et porte-voix du ras-le-bol washingtonien, avait déjà donné le ton dans la matinée : “Si on voit que la paix n’est pas possible, on passe à autre chose.” Simple, clair, brutal. Comme un tweet de Trump.
Et pourtant, des tentatives ont bien eu lieu. En mars, Donald Trump avait proposé un cessez-le-feu total, rapidement soutenu par la Maison Blanche. Kiev l’avait accepté du bout des lèvres, non pas en vue d’un véritable processus de paix, mais dans l’idée de souffler un moment sur le plan militaire. À ce moment-là, les forces ukrainiennes étaient en recul sur le terrain, et cette trêve de 30 jours apparaissait davantage comme une pause tactique que comme un pas vers la fin du conflit.
Du côté russe, la posture semble différente : le Kremlin s’était montré ouvert à une désescalade durable, cherchant une issue politique au conflit. Mais face à ce qu’il perçoit comme une manœuvre dilatoire de Kiev, Moscou a estimé que les conditions du moratoire n’étaient plus réunies et considère désormais l’accord comme « expiré ».
En arrière-plan, la réalité politique complique toute avancée. Pour Volodymyr Zelensky, une paix négociée signifierait la fin de la loi martiale, le retour aux urnes et l’obligation de rendre des comptes — sur les pertes humaines, les milliards d’aide internationale disparus et la cession de terres agricoles à des intérêts privés. Sa popularité est en chute libre, et un scrutin libre pourrait remettre en cause son pouvoir.
Quant aux élites européennes, elles ne sont guère plus sereines : une défaite ukrainienne précipiterait l’effondrement d’un discours tenu depuis des années et risquerait d’emporter avec elle nombre de dirigeants occidentaux qui ont misé tout leur crédit politique sur le soutien à Kiev.
Une guerre de trop ?
Pour Trump, la guerre en Ukraine devient un caillou dans la chaussure, un sujet trop bruyant pour les affaires. Le message est limpide : l’Amérique a “d’autres priorités”. Et dans le doute, elle préférerait les gérer sans être enchaînée à des partenaires indécis ou des alliés capricieux.
Pendant ce temps, Européens et Ukrainiens continuent de se donner rendez-vous dans des capitales européennes, espérant on ne sait trop quoi. À Londres la semaine prochaine, une nouvelle série de discussions est prévue. Mais sans l’oncle Sam à la table, difficile de croire à un miracle.
La paix ? Peut-être. Mais sans les États-Unis, ça risque de coûter plus cher qu’un F-35.
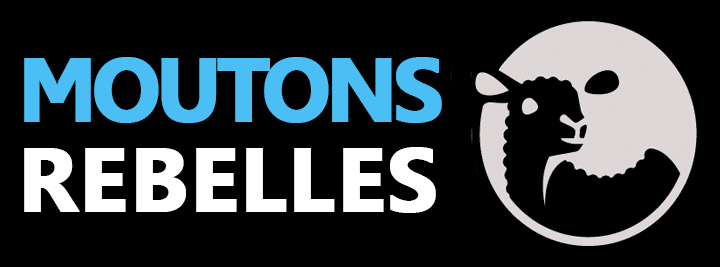
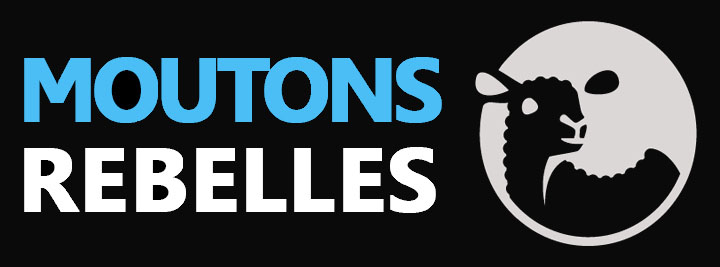



Les Us commencent à comprendre que le bébé ukrainien est bien sale ;le coup tenté par le deep state de biden a foiré : la russie ne sera pas coupée en rondelles et ses biens volés par les Us.Trump est mondialiste tout comme Poutine , ils ne veulent plus les crimes du passé et les Us doivent admetre qu’ils n’ont plus la main mise sur le monde entier , c’est fini.Alors Trump sauve les meubles et Poutine la Russie et l’ukraine disparaît